Rencontre avec Pascal Nampemanla Traore
- noirconcept
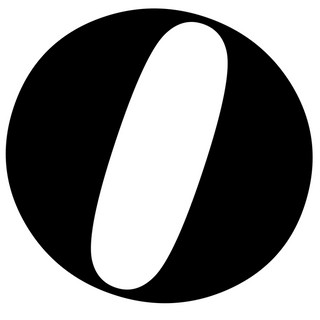
- 13 juil. 2022
- 4 min de lecture

Qui êtes-vous Pascal Nampémanla Traoré ?
Il faut remonter à l’enfance, aux origines, à mon lieu de naissance. Je viens du village de Kpéfélé, à côté de Katiola, au Nord de la Côte d’Ivoire. Je suis issu du peuple Tagbana qui est de la famille des Sénoufos connus pour leur tradition de masques et une culture très ancrée, très forte avec des cycles d’initiation. J’ai quitté très tôt ce berceau de traditions pour aller dans le Sud de la Côte d’Ivoire, à Rubino chez mon oncle qui était enseignant. Je suis retourné pour la première fois dans mon village vers l’âge de 15 ans. Mais j’ai gardé une image intacte de ce royaume d’enfance : des odeurs, des rues, plein de choses.
Dès la classe de CE1, je me suis mis à dessiner. Et à la demande de mes enseignants, je faisais le tour des classes pour illustrer les apprentissages de la semaine suivante. C’était ma corvée de chaque dimanche mais aussi mes premiers exercices. Et puis j’avais un aîné qui était dans une école d’art à Bingerville qui m’a montré comment faire des ombres, des lumières, des volumes avec le crayon. A la demande de mes parents, j’ai attendu d’obtenir au moins le brevet pour intégrer le Lycée artistique d’Abidjan et par la suite, l’Ecole des Beaux-Arts d’Abidjan.
Votre parcours artistique est riche, dites-nous en plus ?
Au départ, je voulais être sculpteur. Mais au cours de ma formation j’ai découvert la communication et les arts graphiques qui m’ont permis de pratiquer la photographie et la vidéo. Après mes études, j’ai commencé à travailler dans une imprimerie, ensuite dans une agence de publicité. Un jour, je réponds à une annonce dans le quotidien national Fraternité Matin d’une agence qui recrutait un Directeur artistique à Dakar. J’avais déjà lu des choses sur ce qui se passait à Dakar dans la Revue Noire, le travail de Bouna Médoune Sèye, le milieu du cinéma, Joe Ouakam, j’avais le sentiment qu’il y avait un bouillonnement créatif au Sénégal. Je me retrouve quelques mois plus tard au Sénégal avec l’idée d’y travailler quelques années et rentrer… Mais j’y suis encore.
C’est lors de la Biennale DAK’ART 2004 que j’ai fait une première expo, « Yeux dans Yeux ». J’ai rencontré le fascinant Joe Ouakam qui a beaucoup compté pour moi et Bouna Médoune Sèye avec qui nous avons cheminé pendant deux ans au gré des résidences de création, de peinture performative et des expositions. Il y avait aussi un groupe d’amis avec qui on manageait un groupe de reggae. J’étais dans un bouillon de cultures et de recherche. A partir de là, malgré la charge de travail, tous les deux ans, je faisais une exposition parce que j’avais beaucoup de choses à dire ! Et souvent, mes questionnements et mon travail interrogeaient la société de consommation…que je voyais de près dans le milieu de la pub. Je me souviens souvent de ma jeunesse où certains objets du quotidien étaient en bois ou en terre cuite. Des objets faits pour durer dans le temps. Aujourd’hui, le monde occidental a occulté tout cela comme si cela n’était plus vrai ou n’avait jamais existé. Dans un mouvement de folie de cette société de consommation, on est passé de l’inaltérable au « tout jetable » parce que cela rapporte de l’argent. C’est un peu le fil conducteur de mon travail. A chaque projet, je saisis un thème et je trouve le médium adapté pour mieux exprimer cette idée. Je travaille sur différents supports du papier d’emballage kraft au papier journal en passant par la photo et la vidéo pour créer un univers et raconter un peu notre humanité. Chaque exposition est une proposition nouvelle. Je ne suis pas à la recherche d’une écriture mais j’ai quelque chose à dire !
A quel moment avez-vous décidé de lâcher la publicité pour vous consacrer pleinement à votre création ?
En 2011, j’ai décidé d’arrêter de travailler dans la publicité parce qu’il y avait des possibilités de résidences d’artistes auxquelles je ne pouvais participer à cause de mon travail en agence qui m’occupait à plein temps. Je sentais que tout mon être était aspiré par ce besoin de création.
La vie d’artiste n’est pas simple tous les jours parce que financièrement c’est toujours instable mais cela vaut la peine de vivre pleinement ce qui nous passionne, ce qui nous habite. Et puis, il y a toujours quelques projets de communication que l’on me confie mais plus dans le cadre de ces grosses boîtes qui font tourner la publicité qui est le moteur de cette société de consommation.
Depuis 2017, je me suis beaucoup impliqué dans le laboratoire AGIT’ART autour de Joe Ouakam avec des projets à forte valeur sociale, notamment dans les écoles en milieu défavorisé pour sensibiliser sur les problèmes environnementaux et aussi réinsérer l’activité artistique en milieu scolaire.
Comment vous est venue l’idée de cette exposition personnelle qu’est « Le Fil d’Ariane » que vous présentez sur tout un étage en chantier au-dessus de la Galerie « Mémoires Africaines » à Saly ?
Cette année, dans le cadre de la biennale de Dakar, j’ai voulu faire la somme de mon travail. C’est une œuvre biographique. J’ai voulu réunir les différentes parties de ce corps, les différentes propositions que j’ai faites depuis 2004 et les mettre en relation en un seul et même lieu. Et je suis parti sur cette idée de « Fil d’Ariane » dans l’esprit d’un labyrinthe, à l’image de mon parcours qui n’est pas linéaire. Il y a de la peinture, de la sculpture, de l’installation, de la photographie, de la vidéo. Les thèmes abordés ont souvent changés et l’expérimentation de plein de matériaux apparaît…
Je crois que les rencontres sont essentielles dans le parcours d’une personne. Lorsque Richard Cousinard m’a proposé d’exposer dans ce lieu, j’ai tout de suite accepté. Et avec des amis et certaines personnes qui me collectionnent déjà, on a fait un crowdfunding pour arriver à monter l’expo.
Propos recueillis à Dakar par Bernard Verschueren.
Crédit photos: Bernard Verschueren.




Commentaires